« Quant aux choses, elles fuient dans un éloignement que nulle pensée ne franchit »
Maurice Merleau-Ponty
« Il faudrait faire la consigne de chaque chose et l’affoler »
Armand Dupuy
Sans doute quelque chose en nous aime la pureté comme on place haut l’évidence du cristal, la façon dans la géométrie qu’à le nom de répondre à la chose.
Que les choses puissent se laisser dire dans ces formes simples, comme relevant d’une certaine transparence.
Alors on souffre de tout compliquer, de patauger, froisser ; de gestes gauches et confusions. On pleure sur l’écart entre les mots et les choses, les expériences et les moyens que l’on a de s’en rendre compte, qui fait de ce que l’on observe là-devant toujours un insaisissable. Malédiction digne de Sisyphe, de Prométhée. Les tempes « cressonnent de fatigue ».
Ce que l’on est, ce que l’on fait, ce à quoi l’on est pris : il semble que tout nous dépasse, nous échappe dans des tombées de plis, à l’extrémité de notre champ visuel, au-delà des espaces que notre intelligence piétine. Nous passons, le monde passe, ou bien tout n’est qu’illusions comme lorsque le train quitte la gare et qu’il nous semble depuis notre immobilité que c’est le quai qui lentement se désarrime et glisse. Ou est-ce que tout va toujours trop vite, dans une succession continue qui ne laisse pas le loisir de considérer longuement tout ce qui le demanderait et fuit dans un chaos brouillé comme à la vitre du train les choses du bas-côté, les buissons de bord de voie ? Le monde est flou. Et même à en observer quelques prélèvements dans le tête à tête de l’étude qui surgissent alors sur la table ou devant soi dans un espace vertigineux, semblable aux têtes, aux corps longilignes et encagés de Giacometti.
On ne sait pas le monde – ou ne fait qu’à le fouiller, le sonder, en chercher les confins, malgré tout ce que l’on ramène que le savoir moins encore. Tout se déplace, se dérobe derrière des doubles déformés, des images artificielles, des artefacts, des ombres portées, des reflets, des discours ou des idées. Il semble que l’on ne peut rien toucher sans toucher du même coup la pulpe des doigts par lesquels on touche.
On drague le fond en soi et verse tout sur le pont, sonnerie du téléphone, mouche passée dans l’œil, cadran d’horloge, odeurs, musiques bêtes, pages lues, fantômes et illusions.
Le journal en cela a quelque chose de désespéré. De proprement monstrueux dans les paradoxes perspectifs et temporels qui le travaillent.
Tout vécu est-il nécessairement appelé à intégrer l’autorité falsificatrice d’un récit ? A prendre des tangentes ?
Guettant ses écueils, remâchant perpétuellement les aliments qu’il fait cailler, il insiste cependant ; celui qui le tient se persuadant comme Descartes qu’un homme égaré dans la forêt trouverait plus sûrement son salut en marchant droit devant lui qu’en errant en tous sens, irrésolu et inconstant, ou s’effondrant sur lui-même sans espoir.
La méthode en devient une ascèse, c’est-à-dire un exercice. Marcher droit et longtemps. Au bout du tunnel, la charité promise. Ça en devient un rituel, s’installer à la table de travail, rouvrir l’écran ou le document, reprendre et quand l’heure approche, « enregistrer sous ». Quand bien ça s’écroule quand on creuse et qu’on voit pas bien si l’ouvrage avance ou n’est que brassée de matières.
Mais ce n’est jamais ça ; ou bien ça l’est sans l’être. L’expérience que l’on a du monde relève d’avantage du portrait cubiste, d’une conjonction monstrueuse que d’un instantané photographique.
Aussi, ce Selfie lent, journal-poème, comme le désigne l’auteur lui-même, m’évoque ces photographies dont le temps de pose enregistre en une même image un fragment étiré de temps, déformant les visages, brouillant en les démultipliant les gestes, effaçant ce qui est passé trop vite pour être retenu. L’objectif aurait été retourné contre soi, ouvert aux événements, à leur chorégraphie. Il aurait été témoin du travail de l’esprit, impliqué à faire retour sur ce qui dans le mouvement de vivre n’était jamais apparu que comme aura, tremblement de l’air marquant la survenue d’un geste. Se sera imprimé d’une succession de traces superposées, confondues parfois, d’où se laisseraient alors lire de nouvelles figures, occasionnelles, fantasmagoriques.
On pense aux esquisses nombreuses, au souvenir des prostituées de Barcelone, à Cézanne, aux influences mêlées de la statuaire ibérique, africaine, d’Ingres qui ont abouti au poème que réalise la toile qu’un autre encore nommera Les demoiselles d’Avignon.
Non, la vérité du poème n’a rien d’un cristal pur. Elle charrie ce qu’en aveugle on n’en finit pas de palper, d’attraper des jours, comme autant d’impacts laissant leur trace à la surface d’une matière sensible. Et pourtant, une forme, on l’espère, en réduction, comme l’on fait des sauces, pourra en faire une sorte de figure, quelque chose se détachant du reste pour venir au plus près vous dévisager et dans ce mouvement vous dire quelque chose d’un socle, une image à glisser dans la poche intérieure. A travers soi, ce à quoi on est pris, le monde. Là où le domestique rejoint le commun.
Quel portrait obtiendrait-on alors ? Celui d’un doute, lessivé, jeté à nouveau en piste et battu, rendu presque fou par la complexité des choses, leur perpétuelle interpénétration, leurs convulsions. Quelqu’un de saoulé de fatigue, acharné pourtant, inlassable tisserand, qui « compose, remaille avec ses miettes » faisant et défaisant la trame en laquelle viennent se prendre les abattis des jours et à travers les difformités de laquelle apparait un homme courbé sur un cahier sur une table de cuisine tôt le matin tenant le monde front contre front.
Armand Dupuy, Selfie lent, éditions faites fioc, 2021.
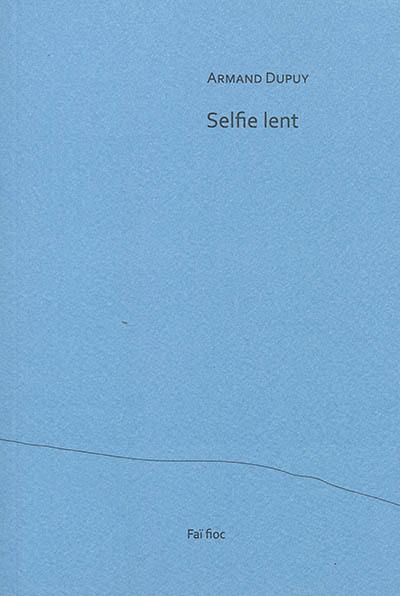
0 commentaires